Quand on parle d’hypnose, on imagine souvent une simple visualisation : fermer les yeux et imaginer une scène proposée par le praticien. Pourtant, ce n’est pas de l’hypnose. Tout le monde peut le faire, sans technique particulière.
Le véritable travail en cabinet commence lorsque le client dépasse ce stade imaginaire et bascule dans un état hypnotique profond : la transe somnambulique. C’est ce point de bascule qui transforme une suggestion en expérience vécue.
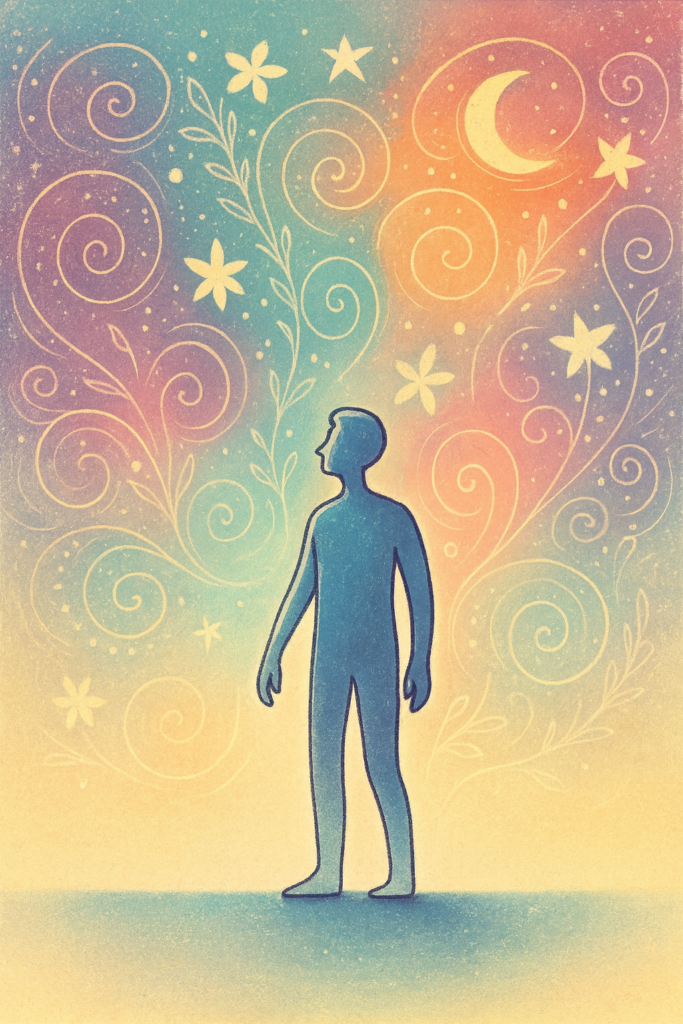
Qu’est-ce que la transe somnambulique ?
La transe somnambulique est un état hypnotique profond mais réactif. Le client vit les phénomènes hypnotiques comme une réalité. Le cortex préfrontal – cette partie du cerveau qui analyse – se met en veille. C’est ce qui permet aux suggestions du praticien de produire un impact réel et mesurable sur le client.
👉 Par exemple :
- un bras collé devient impossible à décoller,
- une hallucination positive ou négative devient crédible pour le cerveau.
C’est ce qui distingue l’hypnose d’un simple exercice d’imagination.
Pourquoi viser la transe somnambulique ?
Parce que c’est dans la transe somnambulique que l’hypnose déploie toute sa puissance, les suggestions ne sont plus de simples « idées », mais des expériences vécues :
- Le praticien n’a pas besoin de convaincre.
- Le client vit l’expérience directement, sans filtre.
- Les changements sont plus rapides et plus profonds.
Dans une transe légère, le client reste dans ses réflexions conscientes, et l’impact est limité. Le travail peut alors ressembler davantage à une démarche psychologique classique — ce qui n’est pas le rôle ni l’approche de l’hypnose telle que je la pratique.
En revanche, en somnambulique chaque phénomène hypnotique devient une preuve vécue, une ressource qui ancre durablement le changement.
Transe somnambulique et transe stuporeuse : deux états à ne pas confondre
La transe somnambulique et la transe stuporeuse sont très différentes.
- La transe stuporeuse : c’est un état de relâchement profond, proche d’une inertie corporelle. La personne peut sembler comme « absente », parfois immobile, difficile à mobiliser. Cet état peut être utile pour un lâcher-prise total, mais il n’est pas efficace pour un travail thérapeutique actif.
- La transe somnambulique : au contraire, c’est un état d’hypnose très profond mais actif. Le sujet participe, vit pleinement des phénomènes hypnotiques (amnésies, catalepsies, hallucinations) et reste mobilisable. C’est justement cette interaction qui permet d’accéder à des changements durables.
👉 Autrement dit, la transe stuporeuse « endort », alors que la transe somnambulique « ouvre » à l’expérience et au travail thérapeutique.
Comment atteindre cet état en cabinet ?
Sur le plan théorique, amener un client en somnambulique consiste à valider un certain nombre de phénomènes :
- idéomoteurs,
- catalepsie,
- amnésie (j’en parle dans cet article👉 ici)
- hallucinations…
Ces phénomènes montrent que le facteur critique est contourné et que l’état hypnotique est stabilisé.
En pratique, chaque personne est unique. Le praticien doit donc :
- disposer de plusieurs techniques d’hypnose,
- rester attentif aux réactions du client,
- ajuster et improviser au fil de la séance.
C’est cette réactivité qui permet de guider vers la transe somnambulique.
Chaque induction est unique, mais l’objectif reste le même : amener le client à vivre une expérience hypnotique marquante, durable et transformatrice. Vous trouverez plusieurs exemples dans mes livres « Hypnose dans la tête d’un praticiens »
Un apprentissage concret
Amener vos clients en état somnambulique n’a rien de théorique : c’est une compétence qui se développe dans la pratique. On n’a pas besoin d’attendre des années d’expérience pour induire une transe somnambulique : il faut oser expérimenter, tester… Comme en musique, on apprend d’abord ses gammes (et pour ça, il faut les jouer), puis on peut improviser.
👉 C’est ce que j’enseigne dans ma masterclass « Osez improviser l’hypnose » : apprendre à créer facilement une transe somnambulique, à improviser avec simplicité, et à transformer vos accompagnements.